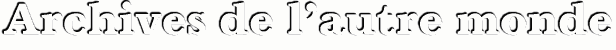| Empêcher
le hold-up des transnationales sur le vivant |
|
Conseil Scientifique de Attac,
Juin 1999
" [...] Terminator est une nécrotechnologie si répugnante
que la campagne internationale d’interdiction en cours réussira
peut-être à la mettre hors la loi. Mais cet arbre ne doit
pas cacher la forêt. Le brevet permet d’atteindre le même
objectif. L’exemple des Etats-Unis le montre. Lorsqu’un
agriculteur veut utiliser des semences de Monsanto ogémisées
et brevetées, il doit s’engager par contrat à ne pas semer
le grain récolté. Si l’agriculteur s’est procuré ces semences
sans signer de contrat, par exemple auprès de voisins, comme
c’est une pratique courante, Monsanto peut alors le poursuivre
devant les tribunaux parce que ces semences sont brevetées.
Pourtant, l’agriculteur avait l’assurance que sa pratique
de semer le grain récolté était un droit. Mais, selon Monsanto
et la bio-industrie, ce droit s’applique aux semences obtenues
par les méthodes ordinaires de sélection, et pas aux semences
ogémisées brevetées !
Le brevet est donc tourné contre l’agriculteur, contre
la faculté des plantes et des animaux de se re-produire,
contre le vivant et, par conséquent, contre chacun d’entre
nous. De même que l’Accord multilatéral sur l’investissement
(AMI) entendait protéger les investisseurs contre les risques
économiques, le brevet, en rendant les plantes et les animaux
légalement stériles, les protège de la malheureuse faculté
des êtres vivants de se re-produire. La mystification d’une
société néolibérale n’est-elle pas de créer des privilèges
nouveaux tout en célébrant le bicentenaire de leur abolition
? Le brevet est un encouragement formidable à généraliser
les techniques de transgénèse aux dépens du travail d’amélioration
des plantes ou des animaux par des méthodes disponibles,
efficaces, mais exemptes (pour l’instant) de privilège pour
quiconque.
Pour faire bonne mesure, Monsanto invite les agriculteurs
à dénoncer leurs voisins “ pirates ” et met à leur disposition
une ligne téléphonique gratuite de délation. Le brevet,
c’est Terminator légalisé, avec l’immense avantage d’éviter
aux transnationales d’avoir à faire ces transgénèses complexes
de stérilisation biologique, et de faire assurer par le
contribuable-citoyen les coûts de sa propre expropriation
! Le brevet permet effectivement, lui aussi," une captation
totale des ressources génétiques ”. [...] "
|
|
Attac
- Texte - Archive
145
| Appel
contre la brevetabilité des gènes humains (Pétition européenne) |
|
Jean-François Mattei, Professeur
de Génétique Médicale, Député Français (DL)
Wolfgang Wodarg, Médecin, Député Allemand (SPD),
Avril 2000
" Je souhaite par ce message attirer l'attention
de la communauté internationale et plus particulièrement
de l'Union Européenne sur la question de la brevetabilité
des gènes humains.
Considérant que le génome humain est un patrimoine commun
de l'Humanité, je refuse l'appropriation des séquences
géniques qu'induit la logique des brevets.
Je m'oppose donc à la transposition en l'état de la directive
européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 et demande un moratoire
immédiat permettant sa renégociation ainsi que la suspension
de toute attribution de brevets sur le génome.
Le corps humain, y compris ses gènes, n'est pas une marchandise.
La gravité de cette question nécessite un débat public
et transparent impliquant les citoyens. Il est urgent
que chaque Etat l'organise avant d'arrêter une décision
lourde de conséquences. Il en va de l'avenir de l'Homme.
"
|
|
| Capitalisme
informationnel et émergence d'une société civique planétaire |
|
Patrick Viveret, Colloque de Morsang
sur Orge, janvier 2000
" [...] Les révolutions agricoles et industrielles,
parce qu’elles s’organisaient principalement autour du
rapport matière/énergie, réduisaient l’intelligence humaine
à une pure fonction d’adaptation aux nouvelles techniques
et aux nouvelles machines. Cette fois c’est la part «
logicielle », donc la matière grise, qui est beaucoup
plus décisive que l’ordinateur lui même dans sa composante
matérielle.
Cette première distinction nous permet de comprendre
que si le capitalisme informationnel utilise pleinement
les potentialités technologiques de l’information numérisée,
il sous utilise en revanche gravement, du fait de sa logique
perpétuée de domination et d’instrumentation des êtres
humains, la formidable fécondité de l’intelligence humaine.
C’est en ce sens que l’on peut dire que si la « révolution
informationnelle » est désormais pleinement engagée, la
« révolution de l’intelligence » reste, elle, pour l’essentiel
à faire. Et ce ne peut être le capitalisme, fut-il informationnel,
qui la réalisera. A la différence de ce que l’on nomme
improprement « intelligence artificielle », l’intelligence
humaine ne fonctionne pas sans désir, à commencer par
le désir de curiosité qui met en mouvement notre volonté
de comprendre et de connaître ce qui nous est au départ
inconnu. Selon que ce désir est orienté positivement vers
la création ou négativement vers l’inhibition (l’angoisse),
l’intelligence humaine, individuelle mais aussi collective,
va utiliser ou stériliser les formidables potentialités
qu’offrent nos quelques cent milliards de neurones. C’est
ici que le capitalisme rencontre des difficultés majeures
puisqu’il réserve le droit à la créativité à une minorité
d’individus et qu’il la réduit à son expression mercantile.
[...] "
|
|
La
loi du marché : des médicaments trop chers
[article de la
campagne pour l'accès aux médicaments essentiels] |
|
Médecins sans frontières,
Campagne pour l'accès aux médicaments
essentiel, ,avril 2001
" [...] Les prix sont particulièrement élevés pour
les médicaments protégés par un brevet. La société propriétaire
de ce brevet détient les droits exclusifs de production
de " son " médicament durant une période qui peut aller
jusqu'à 20 ans. Sur le marché, le producteur est donc
en situation de monopole et peut fixer le prix de son
produit comme bon lui semble. Lorsqu'un brevet vient à
expiration, d'autres entreprises pharmaceutiques peuvent
fabriquer la molécule sous forme générique. La concurrence
entre les producteurs de génériques est telle qu'elle
provoque rapidement une baisse des prix. [...]
[...] Le prix très élevé des médicaments contre le Sida
est injustifié car les instituts de recherche publics
ont grandement financé leur développement. Ainsi, un médicament
d'une importance majeure comme le ddI a été découvert
par un institut de recherche public. Mais il a été ensuite
breveté et commercialisé par Bristol Myers Squibb. [...]"
|
|
Racket
sur le vivant
La menace du complexe génético-industriel |
|
Jean-Pierre Berlan, Richard C.Lewontin,
Le Monde Diplomatique, Décembre 1998
" [...] Ainsi Monsanto, la firme la plus avancée
dans les applications des « sciences de la vie »,
n'hésite pas à publier des placards publicitaires
de menaces dans des journaux agricoles américains.
Sous le titre « Des semences Biotech piratées qui
pourraient vous coûter plus de 1 200 dollars par hectare
à planter », elle rappelle à l'agriculteur qui lui
a acheté les semences en question - génétiquement
modifiées et comportant un gène de résistance à son
herbicide phare, le Roundup - qu'il n'a pas le droit
de conserver une partie du grain récolté comme semence
pour l'année suivante : c'est une « stérilité contractuelle
». Mais l'agriculteur peut s'être procuré du grain
Roundup Ready sans avoir signé de contrat, auprès
de voisins par exemple. Dans ce cas, la firme peut
le poursuivre puisque la variété est protégée par
un brevet : il s'agit cette fois d'une « stérilité
juridique ». [...]
[...] Deuxièmement, l'augmentation historiquement
inouïe des rendements dans les pays industriels, mais
aussi dans nombre de ceux du tiers-monde - ils ont
été multipliés par quatre ou cinq en deux générations,
il en avait fallu douze ou quinze pour qu'ils doublent,
et ils avaient sans doute stagné pendant les millénaires
antérieurs -, repose sur la libre circulation des
connaissances, des ressources génétiques et sur la
recherche publique. La contribution de la recherche
privée a un caractère marginal, y compris aux Etats-Unis,
et y compris pour les « hybrides » de maïs. [...]
[...] Une autre voie est possible : tourner le dos
à la politique européenne actuelle de brevetabilité
du vivant qui ne fait qu'imiter servilement ce que
font les Etats-Unis, et proclamer le vivant « bien
commun de l'humanité » ; réorganiser une recherche
authentiquement publique autour de ce bien commun
pour contrecarrer une mainmise privée déjà très avancée
qui vise à éliminer toute alternative scientifique
permettant une agriculture écologiquement responsable
et durable ; assurer la libre-circulation des connaissances
et des ressources génétiques qui ont permis les extraordinaires
avancées des soixante dernières années ; rendre leur
pouvoir sur le vivant aux agriculteurs, c'est-à-dire
à chacun de nous ; remplacer la guerre économique
et le pillage des ressources génétiques par la coopération
internationale et la paix. [...] "
|
|
| Génoplante
ou la privatisation des laboratoires publics |
|
Jean-Loup Motchane, Le Monde
Diplomatique, septembre 1999
" [...] Génoplante est un groupement d'intérêt
scientifique (GIS) à vocation européenne, créé le
23 février 1999 au siège de l'Institut national de
la recherche agronomique (INRA) ; son objectif est
double : développer un nouveau champ d'investigation
du vivant, la génomique, et permettre « le développement,
la défense et la valorisation d'une forte propriété
industrielle». [...]
[...] Au sein de l'INRA, cette entreprise suscite
l'opposition du syndicat CGT des chercheurs et, au-delà,
fait l'objet de vives critiques dans la communauté
scientifique. Ces critiques portent, d'une part, sur
la subordination de la recherche publique aux intérêts
des grandes firmes, et, d'autre part, sur une politique
de développement de la propriété industrielle conduisant
à la privatisation du vivant, au détriment des agriculteurs
et des citoyens. L'Etat, qui fournit pourtant 70 %
du budget de Génoplante, n'y dispose, au mieux, que
de la moitié des voix. [...] "
|
|
| Droits
de propriété intellectuelle et biodiversité: Les mythes économiques |
|
Fondation Gaia et GRAIN,
octobre 1998
" [...] L'Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) est en train d'accaparer un rôle déterminant
dans la gestion internationale des systèmes de propriété
intellectuelle. Son Accord sur les Aspects des Droits
de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce,
ou ADPIC, définit de nouvelles normes en matière de
droit sur la propriété intellectuelle auxquelles tous
les membres de l'OMC doivent se conformer dans sept
domaines. L'ADPIC est entré en vigueur en 1995, et
devra bientôt être appliqué pleinement dans les pays
en développement (l'échéance pour les pays en développement
et les pays les moins développés étant respectivement
2000 et 2006). Des sanctions commerciales attendent
les pays membres de l'OMC qui tarderont à mettre en
oeuvre les directives de l'ADPIC. [...]
[...] Le discours classique sur la relation entre
les droits de propriété intellectuelle et le développement
économique repose sur un certain nombre de "mythes
économiques". Nous les appelons "mythes" car ils ne
reflètent pas des réalités objectives. Pourtant, ils
sont ingénieusement perpétués dans la conscience sociale
alors même que les économistes sont profondément divisés
sur ces questions. Il est aujourd'hui vital de résister
à ces mythes et de s’en défaire. [...]
[...] Le rôle des droits de propriété intellectuelle
dans la production et la diffusion technologiques
est débattu depuis des décennies. Théoriquement, les
DPI, comme les brevets, devraient contribuer à l'équilibre
entre l'incitation à la recherche et l'innovation
d'une part, et la protection de l'intérêt du public
au sens large d'autre part. Des systèmes de DPI, qui
fournissent aux inventeurs des droits de propriété
exclusifs sur leurs créations, sont supposés avoir
un effet catalytique dans l'innovation technique.
En fait, ceci ne peut pas être démontré. Il n'existe
tout simplement pas de lien de cause à effet.[...]
[...] La valeur économique d'un droit de propriété
se retrouve dans le contrôle accordé au propriétaire
du brevet sur la technologie concernée, les personnes
qu'elle touche, la façon dont elle les touche, pour
quelle période de temps, et à quel coût. Un brevet
n'est pas lié à la santé d'une économie donnée, mais
bien au contrôle potentiel du marché assuré pour le
propriétaire du brevet. C'est la raison pour laquelle
les pays industrialisés continuent à utiliser des
DPI pour geler artificiellement leur privilège technologique
dans l'économie globale.[...]
[...] En l'absence de politiques de concurrence qui
restreignent les pratiques de licence et protègent
l'intérêt public plus large, et sans loi anti-trust
pour bloquer la formation de monopoles, les pays du
Sud seront incapables de gérer les 'distorsions' subséquentes
du marché. [...] "
|
|
Planète
privatisée, défense d'entrer !
Une campagne
contre les brevets sur le vivant |
|
Agir ici, Mars-juillet
2001
" [...] Les textes internationaux et nationaux
légalisant le brevetage du vivant se multiplient.
L’accord sur les Aspects de la propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, entré en vigueur dans le
cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
en 1995, va permettre une généralisation du système
des brevets à l’échelle de la planète. Parallèlement,
une directive concernant la protection des inventions
biotechnologiques a été adoptée par l’Union européenne
en 1998. Il est prévu que celle-ci soit transposée
dans le droit national des pays membres. Il est urgent
de se mobiliser contre sa transposition.
Pour obtenir l’interdiction des brevets sur le vivant,
nous demandons :
- Aux députés français de voter contre la transposition
en droit français de la Directive européenne 98/44
qui autorise le brevetage du vivant ;
- Au Premier ministre d’intervenir auprès de l’Union
européenne pour l’abrogation de la même Directive
;
- Au commissaire européen chargé du Commerce de
négocier auprès de l’OMC l’annulation de l’article
27.3 b de l’accord ADPIC, qui permet le brevetage
du vivant, et de soutenir la position du groupe
des pays africains. [...] "
|
|
L'UESPF
défend les semences de ferme et le tri à façon
[Union Européenne des Semences et Plants de Ferme]
|
|
La Terre, Pour que vive le
monde rural, avril 2001
" [...] Son objectif est d'assurer le maintient
du droit séculaire et inaliénable des paysans d'utiliser
librement la faculté des plantes à se reproduire elles-mêmes.
Selon l'UESPF, La semence de ferme assure, à l'agriculteur,
sa liberté de choix, la conservation de son rendement,
la réduction de ses coûts de mise en production, la
maîtrise de sa production de semences vis à vis des
aléas du marché, la réduction des déplacements de
la semence d'où une meilleure traçabilité et un risque
limité de contamination (exemple, par des OGM). De
part ses atouts la semence de ferme peut remplacer
l'onéreuse semence certifiée. En effet, l'agriculteur
utilisant des semences certifiées débourse entre 250
et 300 F de plus, par hectare ensemencé, qu'un agriculteur
employant des semences de ferme, d'après Alain Gaignerot,
Directeur du Modef, un syndicat d'exploitants agricoles
membre de l'UESPF et de la CNDSF. Par ailleurs, "des
millions d'agriculteurs des pays en voie de développement
n'ont pas les moyens d'acheter des semences certifiées",
souligne Alain Gaignerot.
Depuis plusieurs années, une partie de la filière
des obtenteurs et des organismes multiplicateurs,
c'est-à-dire des producteurs de semences certifiées,
pousse l'Etat Français et l'Union Européenne à réglementer
pour se protéger de la concurrence des agriculteurs
et des entrepreneurs de triage à façon. [...] "
|
|
La
semence de ferme menacée
[ Lettre
aux députés européens ] |
|
Union Européenne des Semences
de Ferme, 18 avril 2001
" [...] Il ne s’agit rien moins que d’une obligation
pour les agriculteurs d’acheter de la semence du commerce
pour bénéficier de la prime P.A.C spécifique blé dur.
Cette contrainte interdit de fait les agriculteurs
à faire leur semence à partir de leur récolte. C’est
là une atteinte à la liberté… C’est aussi une forme
de racket sur les primes P.A.C, puisqu’une partie
de la prime destinée aux agriculteurs se retrouve
directement dans la poche des semenciers.
Quant à la taxation envisagée dans le projet de loi
de 1997, elle revient sur le tapis sous la forme d’une
mission dite de « conciliation », confiée à Monsieur
Grammont, à la demande de la S.I.C.A.S.O.V(1) ainsi
que de l’A.G.P.B(2) et de la F.O.P(3) l’objet de cette
mission étant de trouver le moyen de faire payer une
redevance sur la semence de ferme. La mise en place
de cette taxe qui s’appuie sur le règlement européen
des obtentions végétales est engagée dans plusieurs
pays d’Europe où elle rencontre la réprobation des
agriculteurs qui se mobilisent contre.
Ensemble nous demandons que soient supprimés du règlement
européen :
- La taxation de la semence de ferme.
- La directive qui subordonne les primes P.A.C à l’utilisation
des semences certifiées.
[...] Depuis la création de l’U.P.O.V. la pratique
d’auto-reproduction des semences dans le champ de
l’agriculteur est devenu (aux yeux des semenciers
et du droit qu’ils ont fait mettre en place) une pratique
illégale considérée comme contre façon .Tout cela
s’est fait à l’insu des premiers concernés les agriculteurs
et quand ils en ont eu connaissance les semenciers
ont su leur dire que c’était le progrès pour leur
bien … [...]
[...] Partant des déclarations des semenciers, ils
savent que leur recherche va vers des technologies
qui les rendent maîtres de la reproduction : hybrides,
OGM, et brevetage des plantes. Les paysans européens
à ce niveau partagent les mêmes craintes et revendications
que les pays du sud (groupe des 77) qui exigent que
la liberté de reproduction des plantes soit préservée
et interdite leur brevetabilité. Les semences et plantes
devant être considérées comme patrimoine de l’humanité.
[...] "
|
|
| Petite
histoire des batailles du droit d'auteur |
|
Interview de Anne Latournerie par
powow.net , 2001
" [...] La question de la propriété intellectuelle
et de ses enjeux pose toute une série d'interrogations
connexes qui participent aussi de la réflexion sur
les droits d'auteur : les problèmes liés à la liberté
d'expression et à la censure, à la responsabilité
des auteurs, au statut social des auteurs et à leur
place dans la société, au régime d'autorité, à l'organisation
et au fonctionnement d'un marché.[...]
[...] Dans l'Antiquité, le droit d'auteur ne protégeait
que l'élément de création ou de production, même si
un droit moral de paternité était reconnu. Ainsi le
plagiat était déjà considéré comme une action déshonorante.
[...] Le principe de diffusion n'apparut que beaucoup
plus tard, avec l'invention de l'imprimerie. Du fait
des récents moyens de production et de diffusion à
grande échelle, le livre acquiert une valeur économique.
Une nouvelle catégorie professionnelle apparaît, celle
des imprimeurs-libraires. Elle s'organise en corporations
et en guildes puissantes. La nature de l'activité
nouvelle d'édition suppose des moyens financiers importants
et rend d'autant plus redoutables et préjudiciables
les risques de concurrence et la rivalité entre les
imprimeurs. Il devient essentiel de bénéficier d'un
monopole exclusif pour l'exploitation des ouvrages
édités. Ainsi, apparaît la pratique des privilèges
d¹édition, garantissant un véritable monopole d'exploitation
aux imprimeurs-libraires. L'auteur dans un premier
temps bénéficie donc de cette protection indirecte
par le biais des imprimeurs, qui vont peu à peu pouvoir
les rémunérer.
[...] Deux idées essentielles, qui marqueront pendant
longtemps toute l'histoire française du droit d'auteur,
se dégagent de ces deux textes révolutionnaires :
Un droit exclusif est conféré aux auteurs parce
que leur propriété est la « plus sacrée, la plus personnelle
de toutes les propriétés », puisqu'elle procède du
fruit de la pensée, de la création intellectuelle.
Ce droit est temporaire (l'auteur en jouira pendant
sa vie, puis ses héritiers pendant cinq ou dix ans
après sa mort), parce que l'intérêt public exige aussi,
au nom de la diffusion des oeuvres, que le monopole
ne soit pas éternel, et que l'oeuvre puisse rentrer
dans le domaine public. [...]"
|
|
Le
cyber-communisme
Ou le dépassement
du capitalisme dans le Cyberespace |
|
Richard Barbrook, Multitudes
n° 5, 1999
" [...] Dans un marché entièrement libre, les
éditeurs auraient intérêt à plagier les écrits existants,
plutôt que de débourser de l’argent pour en obtenir
de nouveaux. Les premières nations capitalistes inventèrent
très tôt un palliatif à ce problème économique : le
copyright. Tout le monde pouvait acheter des produits
culturels, mais le droit de les reproduire était réglementé
par la loi. Ainsi, le labeur intellectuel, comme tout
autre travail, put-il lui aussi être l’objet d’une
parcellisation.
Prévoyant cette obsession, certains pionniers essayèrent
bien d’inclure une telle protection du copyright dans
les TCI. Le projet Xanadu de Ted Nelson, par exemple,
comprenait un système sophistiqué de traçage et de
micro payement afin de protéger la propriété intellectuelle.
Son logiciel permettait à différents individus de
travailler ensemble tout en négociant entre eux des
éléments d’information. Mais malgré l’excellence de
sa technique, le projet Xanadu échoua pour des raisons
tenant entièrement du domaine social. Loin d’encourager
la participation, la protection du copyright s’avéra
former un obstacle majeur à la collaboration en ligne.
En effet, la grande majorité des utilisateurs a plus
d’avantages à faire circuler l’information gratuitement
qu’à s’adonner au commerce de commodités. Car en mettant
gratuitement à disposition le fruit de leurs efforts,
les internautes en reçoivent toujours encore plus
d’autres utilisateurs. Face à l’abondance engendrée
par le don, la rareté qui est inhérente au copyright
ne fait tout simplement pas le poids. Loin d’accélérer
la commodification tout azimut, le réseau prouve par
la pratique le bon sens du vieux slogan hacker : l’information
veut être libre.[...]
[...] Aujourd’hui, à l’heure du réseau, c’est sur
le terrain même des avant-postes de la modernité que
cette économie du don met la compétition marchande
au défi. Car ce sont seulement ces nouvelles relations
de production qui pourront réaliser pleinement le
potentiel des forces de production avancées. Quand
les dons numériques circulent librement, les multitudes
peuvent prendre part à la « créativité interactive
». A mesure que l’information est reproduite indéfiniment,
la quantité de travail collectif représentée par chaque
exemplaire tend rapidement à tomber à presque zéro.
Dans de telles conditions sociales et techniques,
la circulation libre de l’information sous forme de
don est non seulement plus plaisante, mais aussi plus
efficace que l’échange marchand. Bien qu’ils apprécient
les avantages du commerce électronique, les Américains
se sont lancés avec enthousiasme dans une nouvelle
forme de travail collectif: le cyber-communisme.[...]"
|
|
| Des
génériques à tout prix |
|
Act Up-Paris, 2001
" [...] On le voit, la sacralisation de la propriété
intellectuelle que les grands groupes technologiques
ont imposé aux politiques du monde entier entraîne
non seulement les PVD, mais aussi les pays riches,
vers des paroxysmes d'horreur économique. La primauté
de l'intérêt public ne doit plus être cantonnée aux
introductions de discours et aux clauses d'exceptions
inutilisables : elle doit redevenir le principe fondateur
de la réflexion sur l'innovation, et cela de manière
très concrète, dans la législation. Ainsi, le sida,
à lui seul, rend aujourd'hui l'OMC caduque, hors propos,
disqualifiée. Lorsque la refonte du droit international
de la propriété intellectuelle dans le cadre de l'OMC
aura lieu, et selon un principe opérationnel de primauté
de l'intérêt public, il conviendra bien de rappeler
aux législateurs de tous pays au moins un fait fondamental
des aspects mondiaux de cette question : la propriété
intellectuelle (et donc les brevets) n'est entre les
mains que des seuls pays développés. [...]
[...] Mais en attendant cette refonte totale de la
propriété intellectuelle, les Etats du Sud n'ont qu'une
option tenable, face aux enjeux de développement,
et de manière plus cruciale encore, face aux crises
sanitaires : l'abolition, pure et simple, de la propriété
intellectuelle pour pouvoir produire massivement des
génériques, sans entrave. L'année dernière, nous réclamions
l'utilisation des "brèches" dans les accords TRIPS.
Aujourd'hui, parce que la pression de l'industrie
pharmaceutique et l'immobilisme des Etats occidentaux
rend impossible leur utilisation, nous exigeons tout
simplement l'abolition de la propriété intellectuelle.
Nous avons fait le choix de sauver des vies."
|
|
| Le
magma contradictoire de la musique en réseau |
|
Alessandro Ludovico, Traduction
de l'italien par Ludovic Prieur et Aris Papathéodorou,
Multitudes n°5, Mai 2001
" [...] Ces initiatives revendiquent avec force
ce qui est un droit d’accès aux savoirs et à l’expression
artistique, et qui ne saurait être limité par les
seules formes de libre marché, si l’on prend en considération
qu’il s’agit d’un patrimoine de l’humanité entière.
En Italie, les initiatives des hacklabs, associations
de virtuoses de la programmation et de la connaissance
du hardware avec une base solide de conscience critique
ont élaboré d’intéressantes positions alternatives
sur ces questions qui ont été particulièrement efficaces.
Dans notre pays, tout produit issu de la créativité,
de l’intellect, et distribué publiquement même gratuitement
doit absolument se voire apposé un timbre de la SIAE
(Société italienne des auteurs et des éditeurs). Le
hacklab de Milan, le LOA, a lancé avec pragmatisme
et détermination un mouvement de sensibilisation au
travers, notamment, de manifestations publiques qui,
sur le plan culturel, allaient à l’encontre de cette
pratique monopolistique qui, dans les faits, ne profite
qu’aux auteurs les plus célèbres. Citons par exemple
une de leurs initiatives où des milliers de timbres
, « simili-SIAE » (appelés « UNSIAE ») ont été distribués
publiquement afin, une fois apposés sur les CD, de
ridiculiser cette pratique de timbrage, avec un slogan
affirmant ouvertement ne prétendre à aucun droit d’auteur
sur l’oeuvre présente. [...]
[...] Le personnage même du DJ [...] compose son
intervention littéraire/musicale au travers des bases
(le vinyle) et les intersections des rythmes, utilisées
à la place des accents et des intonations. Dès lors,
comment est-il possible pour les gérants de clubs
d’établir une liste pour les percepteurs du droit
d’auteur alors même que les DJ utilisent toujours
plus des disques sur lesquels n’existent aucune indication
d’auteur ou de titre du morceau, pour ne pas parler
de l’absence d’étiquette (les fameux « White label
»)? [...]
[...] Les priorités sont nombreuses dans la nouvelle
sphère de production et de consommation musicale.
Avant tout, il s’agit de la défense des espaces de
communication libre et de libre-échange de matériaux
musical à but non-lucratif, qui maintienne à distance
respectable du domaine privé les deux gros lobby.
Qu’il s’agisse de celui de l’industrie discographique,
qui devrait se contenter de produire et de proposer,
et non pas à enquêter sur les échanges interpersonnels
en utilisant l’alibi de la défense du droit d’auteur.
Ou encore celui de l’édition qui ne doit pas limiter
la publication organisée de matériels sur le réseau
par ses règles protectionnistes obsolètes, comme cette
impossible nécessité de disposer de journalistes professionnels
pour donner légitimité à une publication électronique
(référence à un actuel projet de loi italien qui veut
imposer la présence d’un journaliste membre de l’Ordre
des journalistes pour avoir le droit de publier sur
le web. NdT). [...]"
|
|
| Sur
la valeur juridique de la Licence publique générale
de GNU |
|
Mélanie
Clément-fontaine, Multitudes n°5,
Mai 2001
" [...] Selon les termes d'Eben Moglen, l'objet
de la GNU GPL "est de rendre le logiciel libre
en créant un fonds commun auquel chacun peut
ajouter, mais duquel personne ne peut retrancher".
Ainsi non seulement, elle autorise quiconque à
copier, modifier, diffuser le logiciel et garantit
l'accès du code source, mais elle définit
également les conditions de distribution afin
d'empêcher que le logiciel GNU soit transformé
en logiciel propriétaire.[...]
[...] Enfin, il semble douteux que l'on puisse interpréter
la GPL comme une cession des droits de propriété
intellectuelle par l'auteur : non seulement la cession,
selon le Code de la propriété intellectuelle,
ne se présume pas, mais de plus, l'objet et
les dispositions de la licence supposent que l'auteur
entend exercer lui-même ses droits et non les
céder. En effet, l'auteur doit pouvoir contrôler
l'utilisation du logiciel afin d'empêcher quiconque
d'entraver sa libre évolution. [...]"
|
|
Un
espace de déconstruction et construction
L’expérience
du Loa Hacklab de Milan |
|
Entretien avec Blicero, par
Ludovic Prieur et Aris Papathéodorou, Multitudes
n°5, mai 2001
" [...] Nous avons construit une salle de cours
avec des PC i486 et des écrans récupérés dans les
« rebuts » des banques et autres bureaux. Nous avons
seize postes de travail qui offrent tout ce qui est
nécessaire pour suivre les cours et mettre les mains
sur les machines. Nous nous sommes ingéniés et nous
avons réussi a créer un espace didactique qui n’a
rien à envier aux cours commerciaux d’informatique
qui fleurissent actuellement de toutes parts, grâce
a du matériel de récupération, un peu de réflexion
et notre volonté de démontrer que la fuite en avant
vers une technologie toujours plus sophistiquée et
dernier cri est purement et simplement un réflexe
du processus capitaliste; ce dernier nécessitant la
création constante de marchés pour survivre. [...]
[...] Changer la réalité passe aussi au travers du
partage des instruments pour la changer et, dans l’univers
informatico-télématique, c’est très exactement ce
que nous cherchons à faire. Ce n’est pas un hasard
si les concepts de « propriété privée » et de «limitation
de liberté de circulation » des savoirs, mais aussi
des biens et des personnes, sont des éléments sur
lequel se fonde le capitalisme tardif. [...] Comme
on peut le voir en matière de biotechnologies, un
savoir clos, avec des coûts de production mais aussi
d’accessibilité élevés, fait le jeu de ceux qui veulent
la globalisation pour augmenter encore plus leurs
propres profits et leur propre pouvoir. Le partage
horizontal est une pratique « rebelle » à partir même
de ses origines lesquelles sont diamétralement opposées
aux origines du capital. [...]
[...] De même, il est clair que la perspective finale
où tout serait copylefté soit plus que souhaitable
mais il est vrai aussi que la bataille pour forcer
les temps et les grands intérêts relatifs à la réalisation
d’un libre partage des savoirs passe au travers de
l’abolition des lois sur le copyright et de la soustraction
volontaire aux lois que l’on ne partage pas et que
l’on veut éliminer.
D’où la devise « no-Copyright ». Il est certain que
penser à un monde futur dans lequel l’esprit de communauté
rende inutile le concept même de copyright soit un
belle référence pour rêver, mais il n’en reste pas
moins vrai que notre tendance pragmatique nous fait
choisir de faire l’effort auparavant sur les passages
plus praticables, pour par la suite faire le forcing
au-delà. Avec des temps et avec des modalités différents
: la première phase, on se bat pour quelque chose
qui change les mécanismes ne dépendant pas des relations
et des personnes mais qui est effectivement compatible
avec les mécanismes marchands actuellement prédominants;
la seconde phase, est un pari beaucoup plus gros mais
pour lequel on combat tous les jours, aussi bien avec
des mots qu’avec des actes concrets : chercher à
transformer la logique de domination en logique de
communauté, le libre marché en libre partage, l’aliénation
en participation, le fait de déléguer en fait d’agir.
Nous n’en sommes vraiment qu’au tout début, mais nous
vivons projetés dans le futur..."
|
|
|